Cela pourrait vous intéresser…
Un conseil vétérinaire gratuit ?
Posez-nous votre question 🙂
Vos dernières questions :
Conseils illustrés sur le chat
-
 Chat mordeur • Chat qui mordille • Vétérinaire comportementalisteVotre chat vous mord quand vous le caressez ? Il peut être mal éduqué, avoir faim, avoir peur de l'être humain, s'ennuyer... Il peut également être malade ! Découvrez nos conseils concernant ce trouble du comportement
Chat mordeur • Chat qui mordille • Vétérinaire comportementalisteVotre chat vous mord quand vous le caressez ? Il peut être mal éduqué, avoir faim, avoir peur de l'être humain, s'ennuyer... Il peut également être malade ! Découvrez nos conseils concernant ce trouble du comportement
En savoir plus -
 Gamelle anti glouton chat : avis vétérinaire • Guide d’achatPourquoi utiliser une gamelle anti-glouton pour votre chat et quels en sont les bienfaits. Découvrez notre sélection de gamelles anti-glouton...
Gamelle anti glouton chat : avis vétérinaire • Guide d’achatPourquoi utiliser une gamelle anti-glouton pour votre chat et quels en sont les bienfaits. Découvrez notre sélection de gamelles anti-glouton...
En savoir plus -
 Matatabi, cataire, herbe à chat : avis vétérinaire • Jouets pour chatIl ne faut pas confondre l'herbe à chat et l'herbe aux chats. Alors que l'herbe à chat désigne de jeunes pousses et possède des vertus digestives, l'herbe aux chats regroupe différentes plantes comme la cataire et le matatabi, qui ont un effet euphorisant et délassant.
Matatabi, cataire, herbe à chat : avis vétérinaire • Jouets pour chatIl ne faut pas confondre l'herbe à chat et l'herbe aux chats. Alors que l'herbe à chat désigne de jeunes pousses et possède des vertus digestives, l'herbe aux chats regroupe différentes plantes comme la cataire et le matatabi, qui ont un effet euphorisant et délassant.
En savoir plus -
 Mon chat fait pipi partout alors qu’il était propreVotre chat fait pipi sur votre lit, sur vos vêtements ou vos chaussures, dans vos plantes : découvrez comment réduire la malpropreté urinaire chez votre chat
Mon chat fait pipi partout alors qu’il était propreVotre chat fait pipi sur votre lit, sur vos vêtements ou vos chaussures, dans vos plantes : découvrez comment réduire la malpropreté urinaire chez votre chat
En savoir plus
Conseils illustrés sur le chien
-
 Dog Chef : avis vétérinaire en nutritionDécouvrez Dog Chef, des recettes préparées avec des ingrédients naturels, frais, sans conservateurs ni produits artificiels, et équivalents en qualité et appétence à l’alimentation humaine.
Dog Chef : avis vétérinaire en nutritionDécouvrez Dog Chef, des recettes préparées avec des ingrédients naturels, frais, sans conservateurs ni produits artificiels, et équivalents en qualité et appétence à l’alimentation humaine.
En savoir plus -
 Glandes anales du chien : symptômes, traitement, comment les viderLes glandes anales sont situées de part et d’autre de l’anus. Si votre chien se lèche ou se traîne les fesses au sol en se tractant avec ses pattes arrières, cela indique que ses glandes anales sont engorgées. Il est alors nécessaire de les vidanger avant qu'elle ne s'infectent !
Glandes anales du chien : symptômes, traitement, comment les viderLes glandes anales sont situées de part et d’autre de l’anus. Si votre chien se lèche ou se traîne les fesses au sol en se tractant avec ses pattes arrières, cela indique que ses glandes anales sont engorgées. Il est alors nécessaire de les vidanger avant qu'elle ne s'infectent !
En savoir plus -
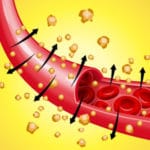 Insuffisance rénale du chien : symptômes, espérance de vieComment soigner une insuffisance rénale chez le chien, une maladie des reins : signes, symptômes, traitement, pronostic et alimentation...
Insuffisance rénale du chien : symptômes, espérance de vieComment soigner une insuffisance rénale chez le chien, une maladie des reins : signes, symptômes, traitement, pronostic et alimentation...
En savoir plus -
 Ultra Premium Direct : avis vétérinaire pour chien et chatConnaissez-vous Ultra Premium Direct ? Des croquettes premium jusqu'à 40% moins cher pour le chien mais également pour le chat
Ultra Premium Direct : avis vétérinaire pour chien et chatConnaissez-vous Ultra Premium Direct ? Des croquettes premium jusqu'à 40% moins cher pour le chien mais également pour le chat
En savoir plus
 Le chat son univers
Le chat son univers Le chien son univers
Le chien son univers